Questions d’accueil des rondes TCI dans les institutions de soins
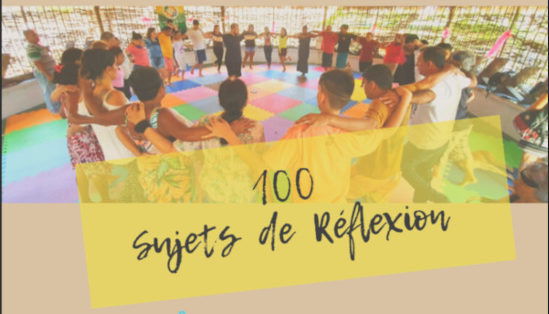
La TCI a été présentée dans des thèses de psychologie et dans un article comme un outil de transformation psychosociale, accueillant les souffrances du quotidien et offrant aux participants des possibilités de les dépasser grâce aux savoirs faire et apprentissages tirés des expériences de vie des membres du groupe de parole.
Donc la TCI ne prétend pas traiter les pathologies mais soulager les souffrances. Cet outil ou mode d’abord favorisant des changements n’est donc pas en concurrence des moyens généralement déployés dans les institutions de soins mais complémentaires, par sa dimension : expression collective et par son objet : la souffrance.
Quels sont les freins, réticences, résistance ou refus de s’approprier ce moyen d’aide dont l’usage a déjà montré sa pertinence et son efficacité ?
Tout d’abord une constante générale pour ne pas dire une banale généralité : tout ce qui est nouveau, dérange. L’adhésion intellectuelle à une bonne idée à l’exercice d’une pratique n’engage pas des changements tant qu’on n’envisage pas de mettre cette pratique en place.
Accueillir ces pratiques c’est forcément un plus, vécu soit comme un plus de travail en plus, soit une aubaine car ça manquait, soit comme un plus qualitatif moyen ou outil qu’il faudra placer, faire de la place donner du temps, un créneau horaire souvent à la place d’autre chose quand les équipes sont bien dotées de programmes de soins et de techniques.
C’est donc un vrai choix de prendre en compte :
- L’intérêt d’un travail d’aide de groupe.
- D’une aide au changement au mieux être qui vient des autres humains non spécialistes et de savoirs non universitaires mais issues de la mine d’or des expériences de vie, habituellement ignoré ou non valorisé.
- De toutes façons, ça dérange !!!
- On l’a vu dans le temps et l’espace mais aussi et peut-être surtout dans les multiples représentations qui fondent les pratiques traditionnelles, particulièrement individuelles.
- Qui c’est qui sait ? Qui a le savoir le pouvoir. La parole du souffrant a-t-elle la même valeur que celle du soignant, la parole de l’instruit du diplômé a-t-elle plus d’importance que celle d’un autre en situation de précarité et de mal être ?
- Un soignant peut-il se mettre sur la même ligne au même rang que les autres participant naturellement dans son simple appareil d’être humain (avec sa vie et ses expériences vécues) dans cet espace de parole et reprendre sa place et ses fonctions en dehors de ce moment particulier.
- Les moyens d’aide individuels ne sont-ils pas suffisants et peut-on faire confiance dans un groupe de parole pour soulager une souffrance personnelle
- Quel est le statut de la souffrance psychosociale ? Sa prise en considération est-elle l’affaire de spécialistes ? Et de quels spécialistes ?
- En bref cela pose entre autres la question du statut et de la posture du soignant et du souffrant. De la qualité de la relation et de sa verticalité (position haute et basse).
- Reconnaissance et acceptation d’un champ ignoré et non pris en compte celui de la souffrance personnelle (psychique, psychosociale.) la TCI ne nie pas le réel, n’a pour ambition de changer la réalité mais d’aider à prendre celle-ci autrement d’offrir d’autres options et savoir faire pour dépasser la situation/problème ou difficulté.
- Est-ce que le concept de souffrance, son expérience, son statut et sa place dans le dispositif d’aide et de soutien dans notre société a une responsabilité dans la résistance que manifestent les institutions ou personnes responsable à sauter le pas (introduire l’outil dans l’éventail des offres) alors qu’ils adhèrent intellectuellement à l’intérêt des rondes TCI.
- Si on garde cette hypothèse comme pertinente, on se doit d’étudier la place de la souffrance dans notre société. Pour ce qui est de son versant somatique la douleur physique les progrès de la médecine ont considérablement modifié le rapport de l’humain à la douleur physique. Comme disait Michel Serre avant la dernière guerre les douleurs accompagnaient les hommes de la naissance à la mort. La médecine efficacement a œuvré pour faire reculer les expressions du Mal, l’âge de mourir et les douleurs physiques ressenties. Au point qu’il parait tout à fait inacceptable actuellement de souffrir dans son corps, alors que cela faisait partie intégrante de la condition humaine de souffrir, dans son corps et dans son « âme » il y a 80 ans. Si la souffrance corporelle s »est trouvée reconnue à condition toutefois de céder aux remèdes médicaux ( les douloureux chroniques ou les malades dits fonctionnels sont des rebelles qui comme des étrangers migrants n’ont pas de place et se ressentent comme persona non grata), les souffrances morales, émotionnelle, sociales… faute d’être reconnues et identifiée comme appartenant au registres et catégories diagnostiquée médicalement ou socialement sont considérés comme le fond commun la condition humaine relevant des aptitudes individuelle à s’en sortir ou du talent familial ou amical à faire des différences.
- Autant dire que la TCI qui déclare que les rondes sont un lieu d’accueil de la souffrance du quotidien pose question et dérange. Est-ce que la souffrance nécessite un lieu d’accueil. Mérite-t-elle d’être reconnu comme expérience méritant considération et moyens adaptés.
- Est-ce que les dispositifs actuels d’écoute individuelle seraient insuffisants ?
- Y a-t-il une place pour une « discipline » ni médicale ni sociale pour répondre à cette réalité ?
- Tout cela est dérangeant comme l’accueil d’un étranger d’un intrus qui réclame une place (sortir de l’utopie. Cela me fait penser à l’addictologie née il y a une dizaine d’années. Tout le monde médical déclarait bien connaitre et soigner les malades alcooliques et leurs descendants drogués, d’ailleurs étaient-ils vraiment malades ? (ce sont les associations d’entraide, Alcooliques Anonymes, Croix bleues… qui ont imposé le concept de malades alcooliques). Neurologie, psychiatrie, gastroentérologie entre autres se sentaient légitimes pour (mal)traiter ces patients à condition d’avoir l’obligeance de présenter une maladie, des troubles organiques suffisant.
- La réalité de maltraitance et de non-reconnaissance de ces personnes souffrantes à amener la naissance de cette discipline transversale d’addictologie et se pousser un peu pour lui faire une place reconnaitre un espace de compétence et d’activité.
- Autant dire la meilleure diplomatie du monde ne peut néanmoins éviter de remettre en question le modèle actuel de prise en compte des souffrances humaines les manques, les trous dans la raquette, même si on esquive le côté provocateur en insistant que ces rondes ne sont pas en rivalité avec l’existant mais en complémentarité (autre manière d’insister sur la non-reconnaissance et non-prise en compte des expériences de souffrance banales même si elle sont épouvantables).
- Quant à l’annonce que les expériences et savoir-faire acquis au cours de l’existence de chacun sont des moyens d’aide aux dépassements des situations problème, c’est la cerise sur le gâteau. Cela réclame d’assimiler qu’il y d’autres moyen d’aide qu’individuels et que les diplômes et le savoir universitaire peuvent être supplanter dans certains domaines par un savoir ingénu existentiel et expérientiel.
- Seule l’expérience d’assister à une ronde TCI peut légitimer une place et une fonction à ces échanges de paroles solidaires. Mais si le germe est planté on n’est pas au bout du compte.
- L’appellation habituelle TCI suscite comme si on en avait besoin d’autres réticences en français …
- À suivre
- Premier arrêt et point sur la réflexion. Par de nombreux aspects, la TCI représente un OVNI (objet voulant non identifier). Elle sort de l’ordinaire, dérange, provoque, interroge. C’est un objet difficile à accueillir et assimiler car son expérience bouscule le socle d’idées reçues en matière d’aide d’attention et de soutien.
- Le collectif prend la place de l’individuel.
- Le savoir et la connaissance sur le tas à partir des expériences de vie prennent le pas sur le savoir pédagogique.
- À la solution estampillée scientifique, universelle et reconnue prêt à porter ou à penser vient s’offrir des vérités des points de vue des options pour le comment faire autrement.
- Au pouvoir et savoir individuel du spécialiste est proposée ou opposée l’intelligence collective,
- À l’opposition ou complémentarité classique entre curatif et préventif, un outil de changement travaille sur les deux plans
- À la relation verticale, avec celui qui sait, qui donne et l’autre qui reçoit se substitue la relation solidaire de soutien et d’apport réciproque.
- Au traitement qu’on doit à l’autre apparait la notion d’auto-soin, de thérapie par soi même à partir des expériences exprimées par le groupe.
- À l’idée d’incompétence et d’impuissance se vit le réveil de l’estime de soi et la résilience
- Opposition entre expériences, savoir professionnel, expérience de vie et de savoir-faire personnel.
- À la représentation manichéenne séparant ceux qui savent et les ignorants de l’autre subversion finale la TCI puise dans la mine de richesse inépuisable des acquis issus des expériences de vie de chacun. Et à ce jeu-là les apports sont équivalents, il n’y a pas de différence entre les participants.
Alors que faire comment présenter les choses pour dépasser les réticences ?



